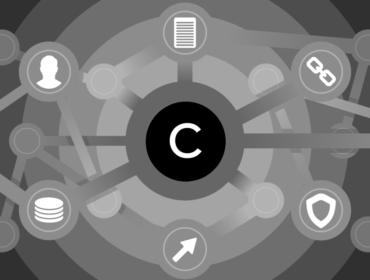Temps de lecture : 5 min
Et si parler des trains qui arrivent à l’heure constituait l’avenir du journalisme ? Au lieu de se focaliser sur un problème, des journalistes font le pari de se concentrer sur les solutions possibles. Leur pratique entend recréer un lien de confiance avec le lectorat, mais demeure trop souvent caricaturée en journalisme de bonnes nouvelles.
Fréquemment taxés de « bisounours », ceux qui pratiquent le journalisme de solutions peinent à faire reconnaître leur travail. Aussi appelé journalisme d’impact, cette approche journalistique souffre encore d’une image légère et peu sérieuse. Par opposition aux hard news et au journalisme d’enquête, qui dans l’imaginaire de la profession représentent ce qu’il y a de plus noble. Pourtant considérée comme un moyen de renouer avec le lectorat, cette pratique finira-t-elle par intégrer les réflexes journalistiques ?
« On n’aura pas le choix », assure Émilie Kovacs, journaliste et auteure de l’ouvrage Journalisme de solutions ou la révolution de l’information. Il s’agit selon elle de la manière la plus efficace de recréer du lien avec les lecteurs, puisque cette approche les inspire et les inclue davantage. « Il est important de sortir de ce qui se fait actuellement, soit le fait d’axer la production journalistique sur les problèmes », poursuit-elle.
À l’heure actuelle, moins d’une dizaine de rédactions françaises ont pleinement intégré le journalisme de solutions, comme le fait Nice-Matin depuis trois ans. La majorité d’entre elles sont d’ailleurs des revues spécialisées, à l’instar de We Demain ou Kaizen. À l’étranger, les pays nordiques sont plus familiers de ce type de contenus. Aux USA, la découverte de la pratique a été tardive, mais a rapidement essaimé. The Seattle Times s’est notamment lancé pour la quatrième année dans une série sur des questions d’éducation. Si le format fonctionne, c’est parce que le thème qu’il aborde « génère un ras-le-bol », analyse Nina Fasciaux, formatrice du Solutions Journalism Network. « À Philadelphie, où il y a un fort taux d’incarcération, plusieurs rédactions se sont associées pendant un an pour produire du contenu sur la réinsertion. Cela a eu un fort impact sur les populations locales », abonde-t-elle, loin d’être à court d’exemples.
Élargir son panel de sujets
Certes le journalisme de solutions peut s’appliquer à tout type de sujet, mais Nina Fasciaux est particulièrement vigilante à la temporalité selon laquelle un thème est traité. « Le journalisme de solutions ne peut pas se pratiquer à n’importe quel moment. Il faut que le lectorat soit déjà conscient du problème exposé. Il ne comprendrait pas qu’on détaille les solutions d’un problème qu’il ne connaît pas », explique-t-elle. Lors de chaque formation, elle s’évertue à déconstruire les a priori des professionnels sur le journalisme de solutions. Nina Fasciaux le reconnaît volontiers, la pratique souffre encore d’un « manque de rigueur ». Elle déplore qu’« on trouve encore trop de contenus légers ou superficiels ». Or, le journalisme de solutions repose sur la même méthode d’investigation que celle pratiquée dans la presse classique. « Pour faire du journalisme de solutions, il faut juste être un bon journaliste. On ne fait qu’ouvrir son panel de sujets », constate la formatrice. Et pourtant, le journalisme de solutions s’apparente parfois à une opération de communication en faveur de l’économie sociale et solidaire. Un autre travers qui nuit à sa crédibilité.
Pour répondre à ces critiques, la formatrice a établi quatre critères à respecter pour s’assurer de la rigueur du journalisme de solutions. En plus de devoir faire figurer la réponse au problème au cœur de la narration, l’histoire doit mettre l’accent sur l’efficacité de celle-ci et non sur les bonnes intentions qui en sont à l’origine. Les limites de l’approche doivent naturellement être traitées pour garantir l’équilibre du papier. Enfin, l’article doit apporter un éclairage nouveau. Une approche partagée par Émilie Kovacs, pour qui il est « cohérent de soulever les solutions. Cela n’a rien d’utopiste. Surtout si c’est bien fait, selon des codes déontologiques. C’est même complémentaire du journalisme d’investigation », note la journaliste.
Pour Sophie Casals, journaliste à la rubrique solutions de Nice-Matin, le changement opère notamment au niveau de l’angle choisi, qui bouleverse les habitudes journalistiques. Elle a en mémoire un travail en commun avec une localière de Nice-Matin sur la parité homme-femme. Sa collègue avait pour réflexe de vouloir associer un interlocuteur à un sujet, tandis que Sophie Casals avait pour principal souci la problématisation du sujet. « L’idée était de poser le problème et de décliner les solutions. Au début, ma collègue n’était pas convaincue. Une fois qu’on a sorti le dossier, elle a reconnu l’intérêt de la démarche », raconte-elle.
« C’est une autre facette du métier. Ce sont des enquêtes et des reportages qui vont plus loin que l’exposition de faits. On montre qu’on peut en sortir. Et c’est cet aspect qui plait aux lecteurs », complète Émilie Kovacs. « Certes on n’est pas dans la polémique, mais en creux on dénonce. On met le doigt sur des problèmes et lorsqu’on pointe les limites des solutions proposées, on peut parfois devenir le poil à gratter de l’administration », assure Sophie Casals.
Il s’agit également d’une piste pour répondre à la crise de confiance qui traverse la presse. Il est toutefois primordial de « ne pas confondre journalisme de solutions et journalisme de bonnes nouvelles. L’idée, c’est de contribuer au progrès, de sortir de l’impasse. C’est même plutôt noble. Ça reste du journalisme, avec de la méthode et de la mise en contexte. On enquête pour trouver ces solutions », renchérit la journaliste.
Retrouver du sens
L’emploi même du terme de journalisme de solutions fait pourtant débat au sein des rédactions. « Le journalisme de solutions porte mal son nom. Le terme suggère qu’on a la solution au problème, or on ne fait qu’apporter des réponses », analyse Nina Fasciaux. Quant à Antoine Lannuzel, rédacteur en chef du web chez We Demain, il explique que le magazine ne se revendique pas du journalisme de solutions. Chez We Demain, on fait du « journalisme tout court ».
« C’est plutôt dans la façon de raconter que ça change. Nous, on a choisi de raconter ceux qui font. Et cela suppose d’enquêter sur les problèmes aussi. La question, c’est comment on prend le problème ? Notre pari, c’est d’être avec les gens qui prennent des initiatives, sans tomber dans l’angélisme », assure Antoine Lannuzel. « Dans l’absolu, on ne devrait pas lui donner de nom. On ne parle pas à l’inverse de journalisme de catastrophe », estime Christian de Boisredon, le fondateur de Sparknews.
Chez Nice-Matin, même constat : les limites font partie intégrante de la démarche. « Quand un projet est bon mais qu’il manque de moyens, ou alors qu’il n’est applicable qu’à un territoire réduit, on le dit. Cela suppose de trouver des interlocuteurs pertinents, d’avoir suffisamment de data pour traiter le sujet, et de le faire de manière exigeante », explique Sophie Casals. Au fond, la pratique du journalisme de solutions constitue pour elle un « retour aux fondamentaux. On se met au service de nos lecteurs, chose qu’on avait parfois oubliée. L’idée, c’est de répondre à la question « et maintenant, on fait quoi ? », de se rendre utile. Ça redonne du sens à ce que l’on fait en tant que journaliste. »