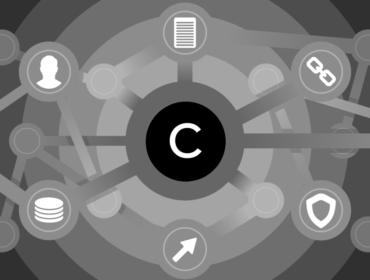Temps de lecture : 9 minutes
Modèle informatif en vogue, le journalisme long format veut casser les codes de l’actualité instantanée en proposant des contenus immersifs et approfondis. Un retour aux fondamentaux de la profession qui se heurte néanmoins à certaines limites.
Ils ont décidé de tenter l’aventure en France en septembre 2018, après une expérience avortée l’année précédente. Le bimestriel francophone Imagine demain le monde, disponible dans 530 points de vente dans l’Hexagone, propose une information innovante et critique sur les grandes questions de société. Le média belge assume s’inscrire dans le courant du slow journalism, un terme à la mode depuis une dizaine d’années.
Depuis la revue trimestrielle XXI, lancée en 2008, de nombreux magazines et webmédias ont fait le pari d’un traitement plus approfondi de l’actualité, avec une part importante de contextualisation. L’objectif : prendre du recul face à la tyrannie de la hard news, une information brute relayée sans profondeur ni analyse. Un flot continu de nouvelles dans lequel le public se retrouve noyé, généralement à son insu. Avec l’avènement d’Internet et de l’infobésité, la durée de vie d’une actualité s’amenuise : chacune chasse l’autre dans un tourbillon permanent.
Pour le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, « la majorité de nos actions ne sont pas guidées par nos valeurs, mais par notre agenda. Toute notre vie est soumise à cette logique d’augmentation, de compétition et d’accélération. » Pour ne pas céder à cette course de vitesse de l’information, les titres assumant leur approche slow se sont multipliés, en France comme à l’étranger. Tour d’horizon de quelques initiatives en la matière.
Entre reportage et analyse
Le terme de slow journalism, appelé aussi slow content, ne repose pas sur une définition universelle. Chaque acteur de ce courant a sa vision, sa méthode, sa pratique. Mais tous s’accordent sur un point : la nécessité de repenser la temporalité médiatique. Dans le but avoué de proposer un contenu plus dense, plus immersif, à la durée de vie plus longue, à la croisée des chemins entre reportage et analyse.

Fidéliser le lecteur
Le courant du journalisme long format repose avant tout sur une identité éditoriale forte et distinctive, permettant de créer un lien de confiance avec le lecteur. Assumant sa rupture avec les médias traditionnels, il propose des contenus immersifs qui captent le lecteur, et le fidélise mieux que n’importe quel autre article.
« Il est incontestable, quand on voit le succès d’un certain nombre de formats, qu’il existe un public qui attend des contenus plus longs et plus approfondis, souligne Arnaud Mercier, professeur à l’université Panthéon-Assas et président du site The Conversation France. Le succès de mooks comme XXI montre qu’il y a des gens qui sont demandeurs de formats avec une temporalité de consommation différente de la quotidienneté et de l’urgence. C’est un public de gens lettrés, plus âgés, qui ont le temps de s’informer. On prend le temps de traiter l’info autrement et de lui donner plus de profondeur. »
« Il y a des tendances assez lourdes qui se dessinent dans les usages de l’information, affirme de son côté Pierre Leibovici, cofondateur de L’Imprévu. La surcharge informationnelle nous touche tous. Il y a une envie de la part d’un certain nombre de lecteurs de changer de temporalité, et de la part de certains journalistes de sortir de ce flux, de ce direct permanent. »
Pour Erik Neveu, professeur à l’IEP de Rennes et sociologue des médias, le lecteur doit apprendre à consommer l’information à travers de nouveaux formats. Le travail du journaliste, lui, consiste à trouver le juste milieu entre longueur du récit et synthétisation du propos.
[…] En tant que lecteur ou consommateur, on doit apprendre de nouveaux formats auxquels on n’est pas habitués […] On rentre dans un nouvel univers de récit qui n’est pas décanté. C’est ce qui est excitant, notamment pour le journaliste.
Plutôt deep que slow ?
Face à l’enracinement du slow journalism, chaque titre doit désormais se renouveler et se démarquer de son concurrent. Beaucoup de médias, à l’image du site lesjours.fr, misent sur deux axes : la qualité et l’exclusivité, de manière à ce que le lecteur qui paye pour un contenu spécifique ne retrouve pas celui-ci ailleurs.
« Il est essentiel d’avoir une relation avec nos lecteurs», assure Raphaël Garrigos, codirecteur de la rédaction du média en ligne. «On a voulu aller contre la logique du clic. Si on vend une information, il ne faut pas qu’elle soit ailleurs. Plus on creuse un sujet, plus on obtient d’infos que les autres n’ont pas. D’ailleurs, je préfère le terme de deep journalism à celui de slow : on n’est pas lent, mais plus long, plus profond. On a une relation horizontale avec le public, d’égal à égal, transparente. »
David Wolf, rédacteur en chef de la rubrique The Long Read du Guardian, met à disposition ses articles parus dans le quotidien britannique sur la toile, afin de toucher un public plus large. Depuis 2014, son succès ne cesse de s’accroître. « Deux fois par semaine, nous publions nos productions sur le web, sous forme de podcasts. Elles rencontrent un franc succès, notamment envers les jeunes publics, qui sont pourtant de grands consommateurs d’info-snack et qui s’informent surtout à la télévision. »
Isabelle Meuret, enseignante-chercheuse à l’Université libre de Bruxelles, a réalisé plusieurs travaux sur les liens entre récit et journalisme. Elle pointe un autre élément indispensable au succès des contenus longs formats : la qualité du storytelling. « L’écriture va de pair avec la méthode utilisée. On peut réaliser une enquête très pointue, mais si l’on n’arrive pas à la raconter, on ne fait pas passer le message au lecteur. Inversement, on peut lire un très beau reportage mais s’il n’est pas nourri par une investigation fouillée, ça ne fonctionne pas non plus. »
Patrick Vallélian, rédacteur en chef du pure player suisse Sept.info partage cet avis. Selon lui, le slow journalism est indissociable d’une écriture comparable à « une forme de littérature du réel, où l’on prend le temps d’éclairer différemment sur des sujets de fond, avec, toujours au cœur, le travail de terrain ».
Un modèle économique bancal
Du contenu qualitatif, exclusif, avec un design soigné et un récit rythmé, telle est la recette pour parvenir à intéresser et fidéliser le lecteur. Mais la pratique se heurte à certaines limites factuelles. La première, et la plus importante, c’est qu’elle repose sur un modèle économique bancal : comment réaliser exclusivement des contenus longs sans être certain des retombées financières ?
Ces enjeux financiers, Raphaël Garrigos en a pleinement conscience. En prenant l’exemple de l’affaire Théo L., il met en exergue le rapport entre le temps passé sur le terrain et le faible retour sur investissement qui en résulte.
La principale et la seule contrainte du deep journalism est d’accepter que les gens travaillent sans publier, qu’ils soient payés à travailler dans l’ombre. On n’a pas la volonté de faire du journalisme autrement, on a la volonté de faire du bon journalisme.
« La presse quotidienne, par exemple, ne peut pas faire tout son contenu sur du slow, explique Arnaud Mercier. Elle est là pour apporter des réponses immédiates de compréhension et d’information sur ce qui ce passe ici et maintenant. Même si on peut envisager qu’il y ait des espaces consacrés, la vraie limite devient budgétaire. Le slow journalism est de plus en plus perçu comme un luxe. »
« Le fait de travailler sur une temporalité différente, pour un journaliste, consiste à rechercher de l’originalité dans son contenu, approfondir un sujet, passer plus de temps et d’énergie. Aujourd’hui, les rédactions ne sont pas orientées vers cela, déplore Pierre Leibovici. Quand on est une petite structure et qu’on n’a pas un gros capital financier, c’est très dur d’exister dans le paysage médiatique. »
Exister dans ce monde ultra-concurrentiel, L’Imprévu a essayé, tant bien que mal, durant trois ans. L’aventure s’est terminée en juin 2018, après une campagne de levée de fonds non-concluante. « On pense que l’on s’est trompés en choisissant le support web et le support écrit, et en revenant sur les événements oubliés, déconnectés de l’actualité », avoue son cofondateur. Trop dur, trop ambitieux de convaincre le lecteur de payer pour des informations trop éloignées de ses préoccupations quotidiennes.
Des difficultés qu’a également rencontrées Florian Laval, cofondateur du pure-player régional Revue Far Ouest. « Dans le secteur de la presse, il y a deux types de concurrence : celle économique, et celle de l’attention. Un média n’est pas là pour être rentable, il s’apparente à une démarche de service public. De ce fait, comment monétiser la marque pour financer la partie média ?, s’interroge-t-il. L’attention est également difficile à capter, le lecteur est énormément sollicité sur le net. C’est un secteur fragile et très concurrentiel. »
L’autre problématique revêt un caractère technique. Le grand public, qui suit désormais l’actualité sur portable, passe en effet de moins en moins de temps sur un article. « Le fait que l’on s’informe majoritairement avec un smartphone ne facilite pas la lecture d’articles grands formats, poursuit Leibovici. Il faut interroger les pratiques informationnelles. Par exemple, un format texte captera moins l’attention qu’un format vidéo. Intéresser le public est un vrai défi quand on fait du slow. »
L’avenir de la profession ?
Pour se démarquer et fidéliser, les médias long format doivent proposer des productions novatrices, intuitives et pertinentes. « Le slow journalism devrait occuper une place plus importante, analyse David Wolf, mais il s’oppose à notre consommation actuelle de l’information et aux formes traditionnelles du journalisme telles que nous les connaissons actuellement. » « Il est nécessaire de faire le ménage face à cette junk info de plus en plus envahissante, où tout le monde se considère journaliste et se sent légitime pour publier n’importe quoi. Le slow, c’est l’antidote, une des réponses face à un phénomène de société et cette tyrannie de l’opinion et de l’instantanéité », estime Meuret. « Contrairement à ce que préconise le slow journalism, il n’est pas une réponse globale à la crise de confiance dans les médias, tempère Mercier. Sa plus grosse limite, c’est celle qui consiste à le présenter comme une réponse à la crise de presse. »
Il ne serait donc pas la solution miracle à la défiance de la profession. Mais le slow journalism s’affirme comme l’un des moyens incontournables pour tendre vers une pratique journalistique moins instantanée et plus approfondie. Et participer, à sa manière, au renouveau de la presse et au regain de confiance du grand public.